Depuis 27 ans, nous faisons avancer les droits humains des personnes vivant avec le VIH et le sida, à risque ou affectées autrement. Nous demandons inlassablement la fin de la criminalisation du VIH, l’adoption de politiques justes en matière de drogues (y compris en prison), le respect des droits des travailleuse(-eur)s du sexe ainsi que la reconnaissance juridique et l’équité pour les personnes LGBTQ2. Nous combattons les injustices et promouvons les droits au Canada et dans le monde. Or notre nom et notre logo ne reflétaient plus la terminologie actuelle ni la portée mondiale de notre travail. Le temps était venu de faire peau neuve.
Nous sommes à présent le Réseau juridique VIH. Le changement a beau être subtil, il a un effet. Nous reconnaissons que notre travail dépasse les frontières du Canada – même si c’est ici que nous sommes établi-es et le resterons –, et que le traitement du VIH a grandement progressé, faisant en sorte qu’on peut généralement prévenir la progression vers le sida chez des personnes qui ont accès aux médicaments. Parallèlement, notre travail de défense et de réalisation des droits est essentiel pour prévenir l’infection par le VIH en amont et pour améliorer l’accès aux soins de santé pour les millions de personnes qui en ont besoin. Notre nouveau nom s’accompagne d’un nouveau logo qui embrasse l’esprit militant et la nature collaborative de notre travail et qui reflète notre histoire par son ruban iconique.
Tout au long de ce processus, une chose a été claire : quel que soit notre nom, nous continuerons de militer pour la justice et les droits humains. Rien n’a changé sur ce point.
Il est étrange d’écrire cette lettre maintenant, alors qu’il s’est passé tant de choses depuis la fin de l’exercice 2019-2020. À la fin de mars, le Canada amorçait tout juste son confinement lié à la COVID-19 et nous ne savions pas ce qui nous attendait. Dès le début, nous avons vu des liens clairs entre la COVID et les droits humains. Cette pandémie affectera encore longtemps notre travail et plus généralement la réponse au VIH. Mais pour ce rapport annuel, nous nous concentrerons sur les activités qui ont précédé la COVID-19.
Lors des élections fédérales au Canada en 2019, nous avons veillé à ce que nos enjeux soient au premier plan. Nous avons distribué notre questionnaire à tous les principaux partis politiques, avons compilé et publié leurs réponses et incité les dirigeant-es à financer adéquatement la réponse au VIH, à décriminaliser les drogues, à protéger la santé et la sécurité des travailleuse(-eur)s du sexe, à mettre en œuvre des programmes de seringues et d’aiguilles sûrs et efficaces dans les prisons, et à limiter la criminalisation du VIH. Nous avons également insisté pour que les lois, les politiques et les actions pertinentes à ces domaines soient fondées sur des données probantes et sur les droits humains, tant par notre présence devant les tribunaux que dans les médias et dans nos discussions avec des politicien-nes et des responsables des politiques.
Sur la scène mondiale, nous avons axé nos efforts sur la lutte contre les violations des droits des personnes qui consomment des drogues en Russie, notamment par un soutien juridique direct visant à améliorer l’accès aux services et à combattre la discrimination et les abus, et par des démarches auprès des tribunaux et des organes des Nations Unies pour maintenir la pression en faveur du changement. Nous avons également continué de contester les lois pénales homophobes dans les Caraïbes, où la criminalisation des personnes LGBTQ2 dans certains pays alimente la discrimination, le harcèlement et la violence ainsi que l’épidémie de VIH. Nous avons également contribué à une résistance mondiale croissante à la criminalisation du VIH, notamment en Afrique francophone.
Tout au long de l’année dernière et de l’année à venir, où nous côtoierons les défis soulevés par la COVID-19 et y répondrons, notre travail a été et sera guidé par notre nouveau slogan : Combattre les injustices, faire avancer les droits, transformer des vies. Nous espérons que vous continuerez de nous épauler dans cette quête des droits humains pour tous et toutes, partout — et surtout pour les personnes vivant le VIH, à risque ou affectées autrement.
Dans la solidarité,
Ron Rosenes
Président du conseil d’administration
Richard Elliott
Directeur général

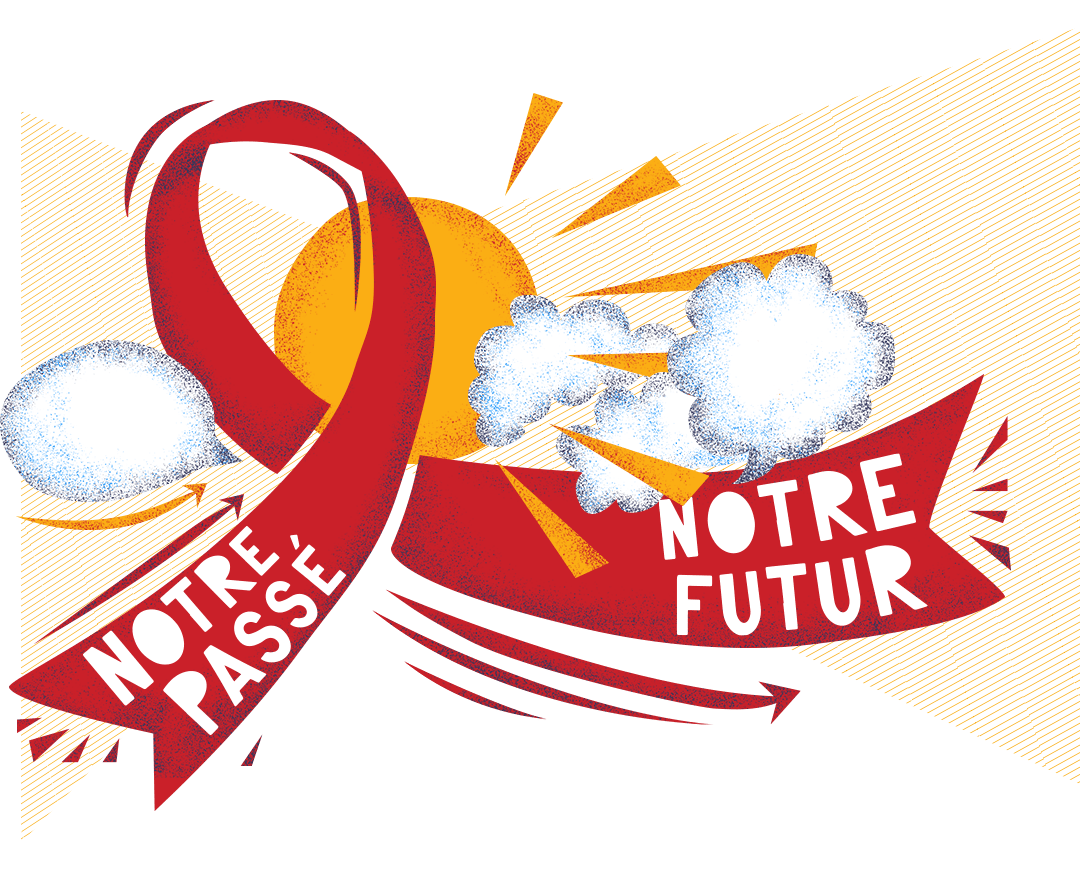

























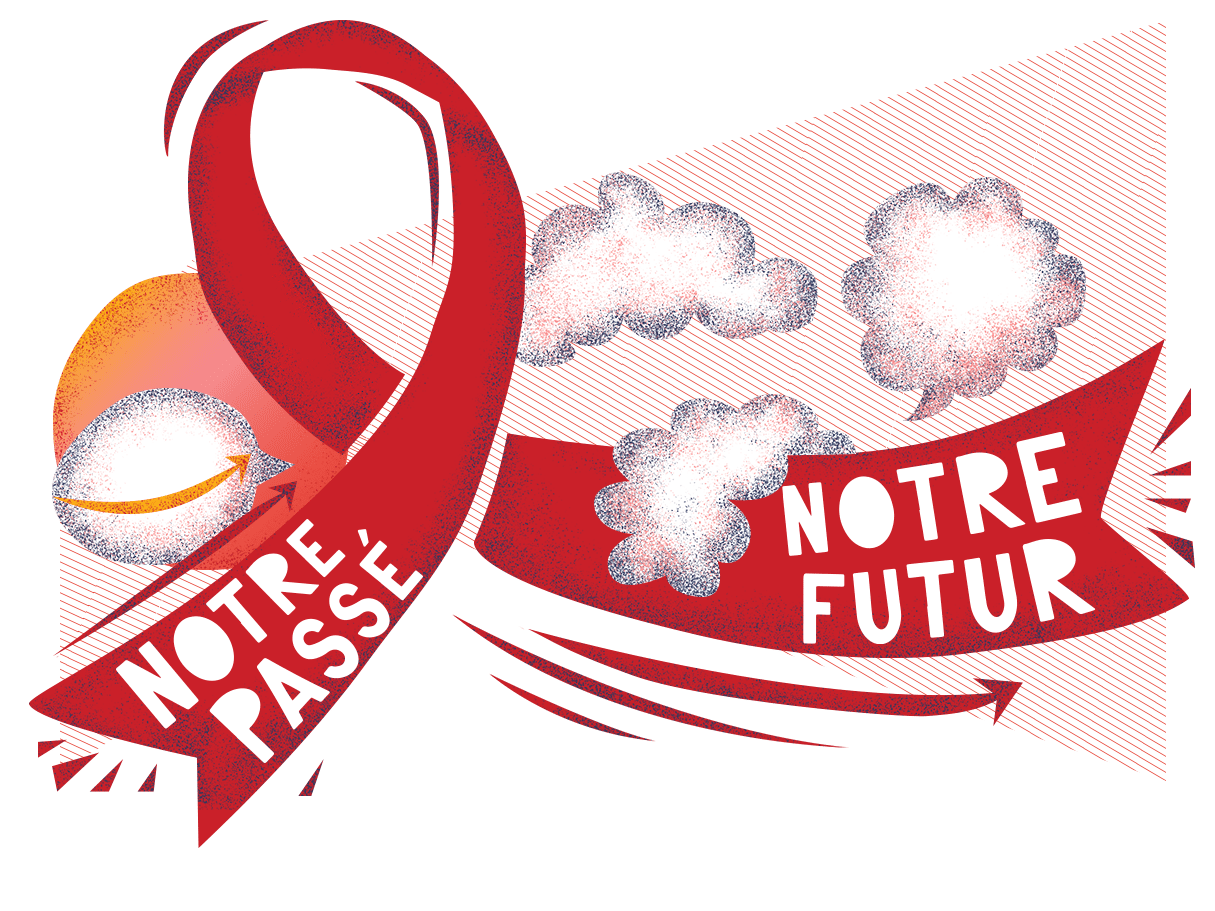

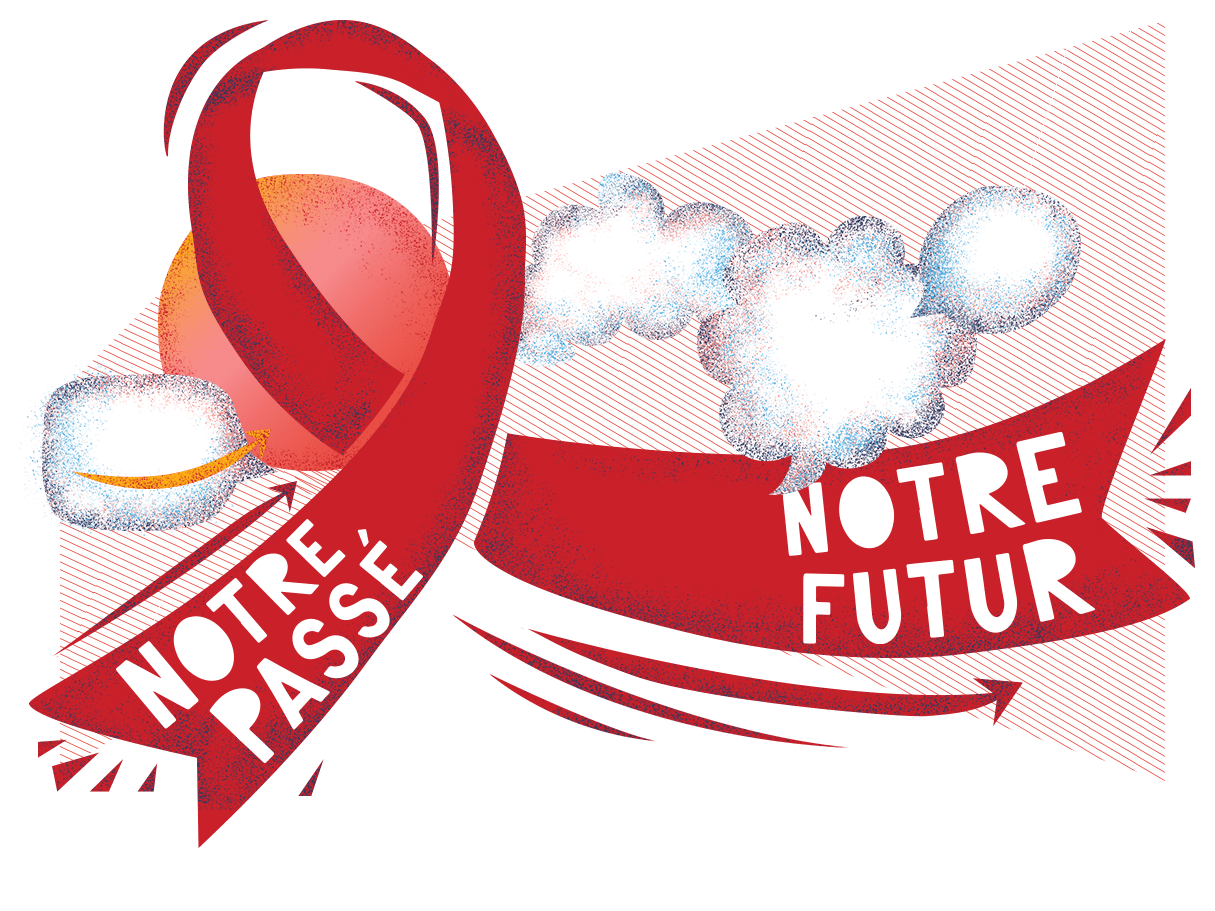

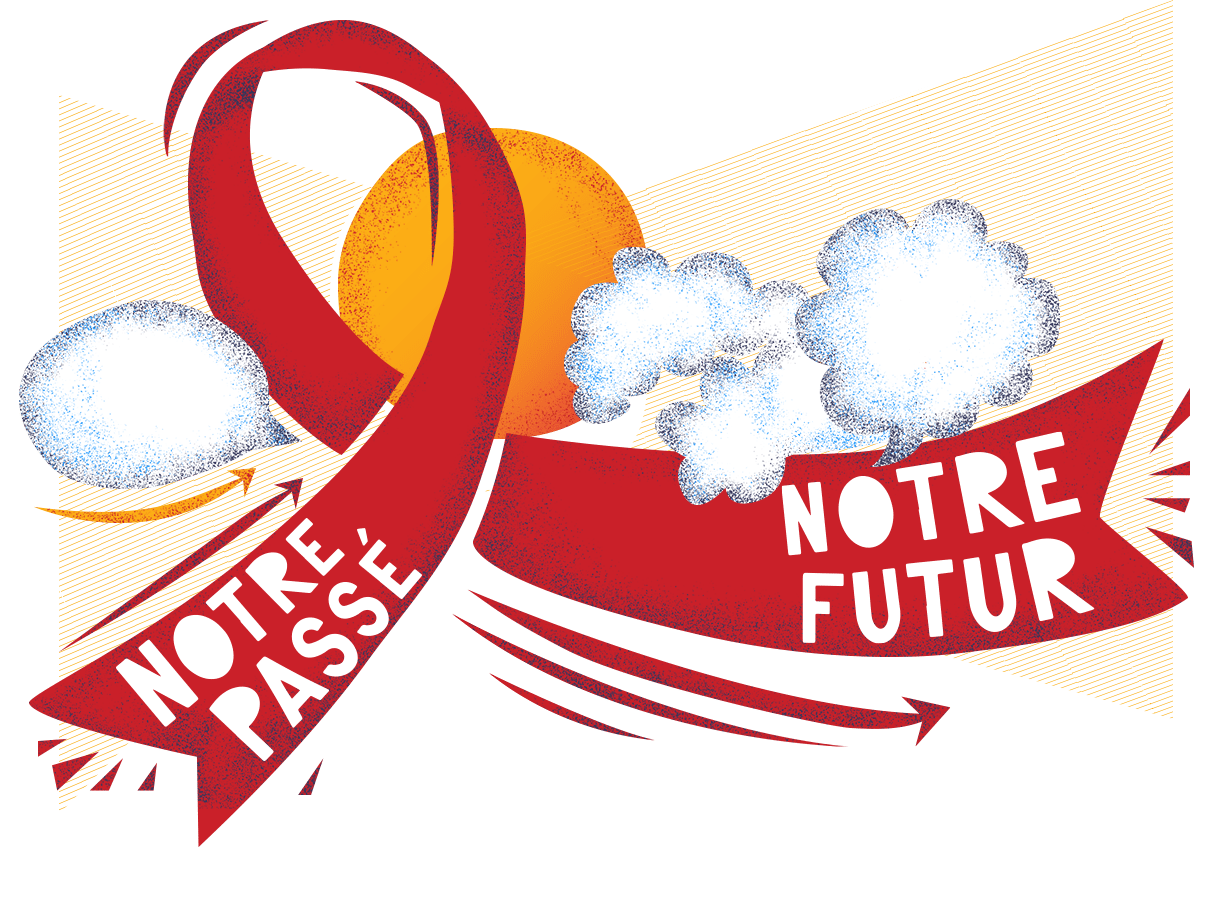

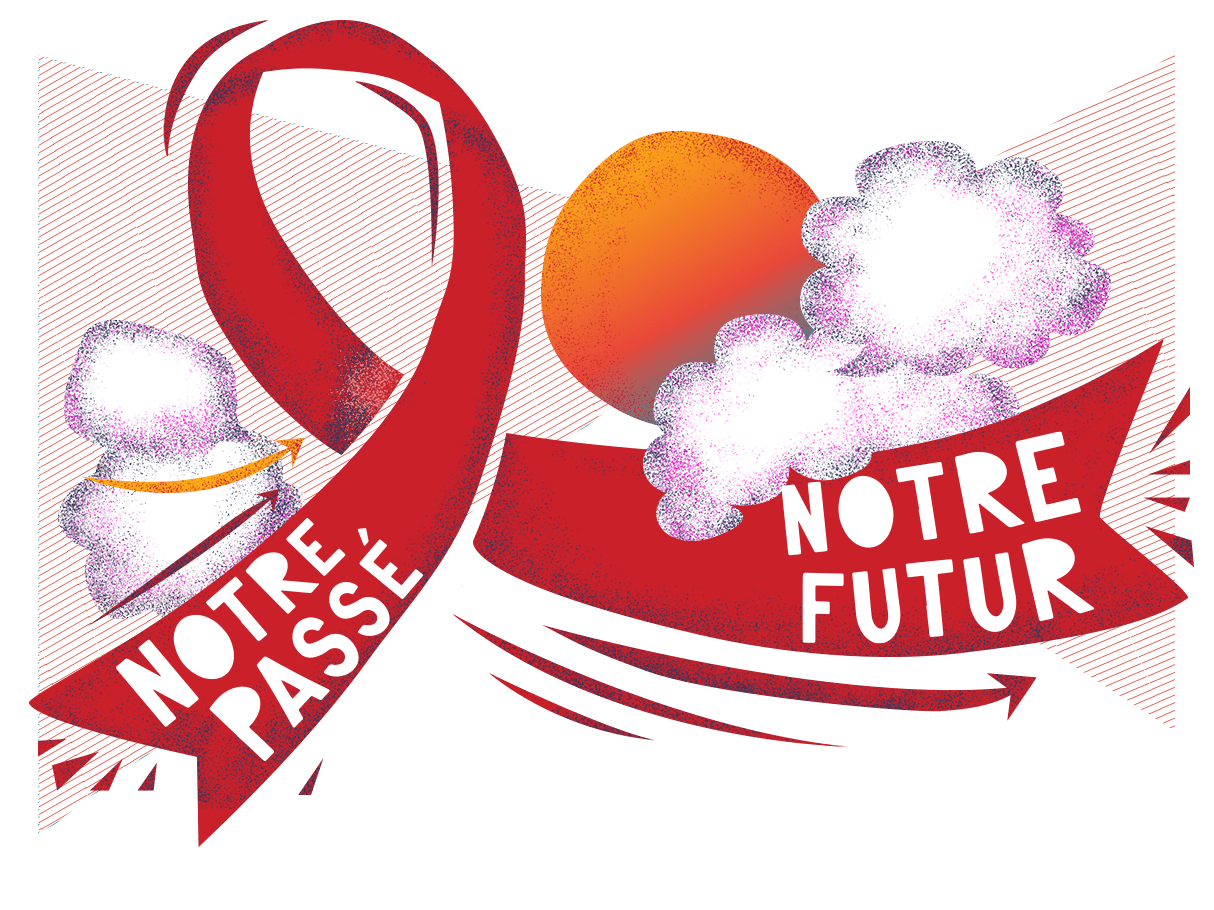
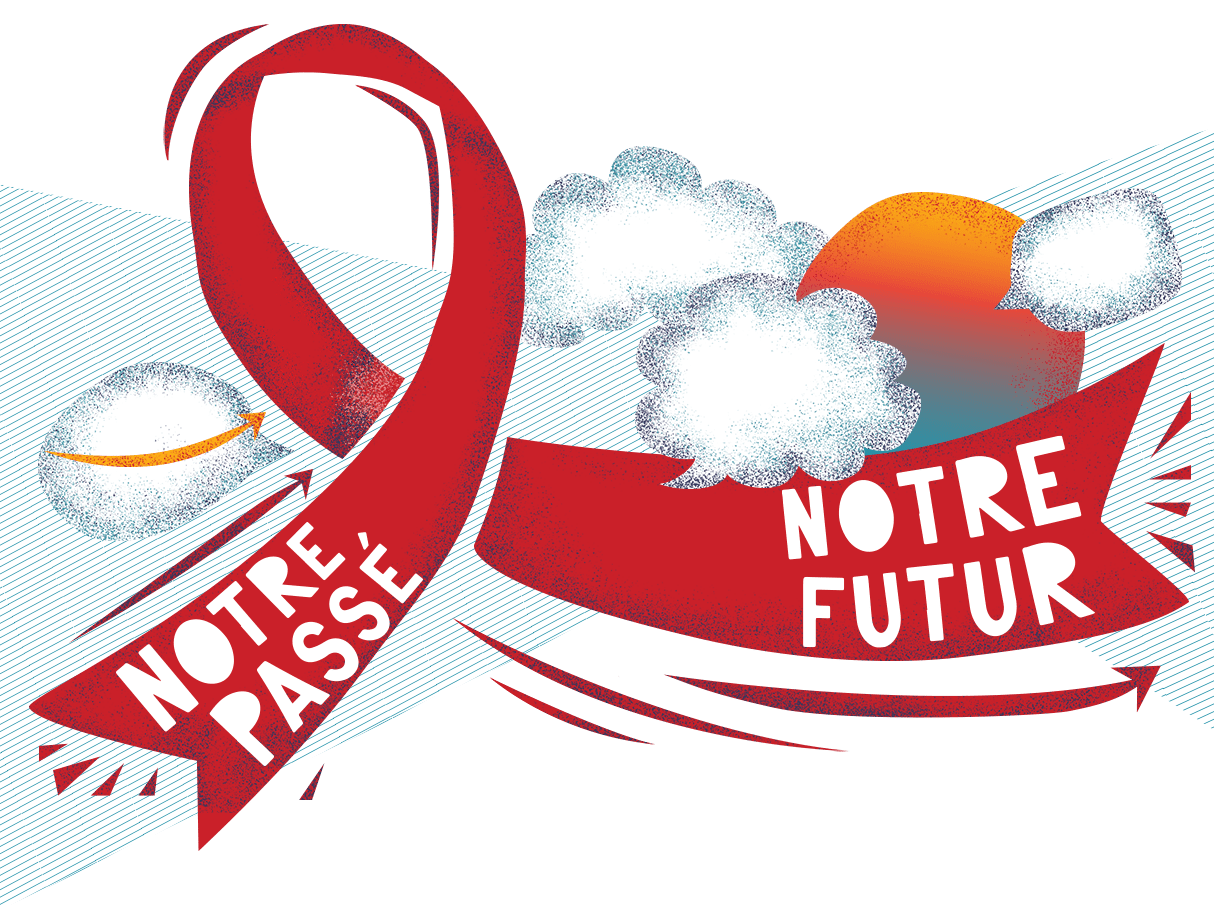
 84% Activités de bienfaisance
84% Activités de bienfaisance 11% Administration
11% Administration 5% Collecte de fonds
5% Collecte de fonds